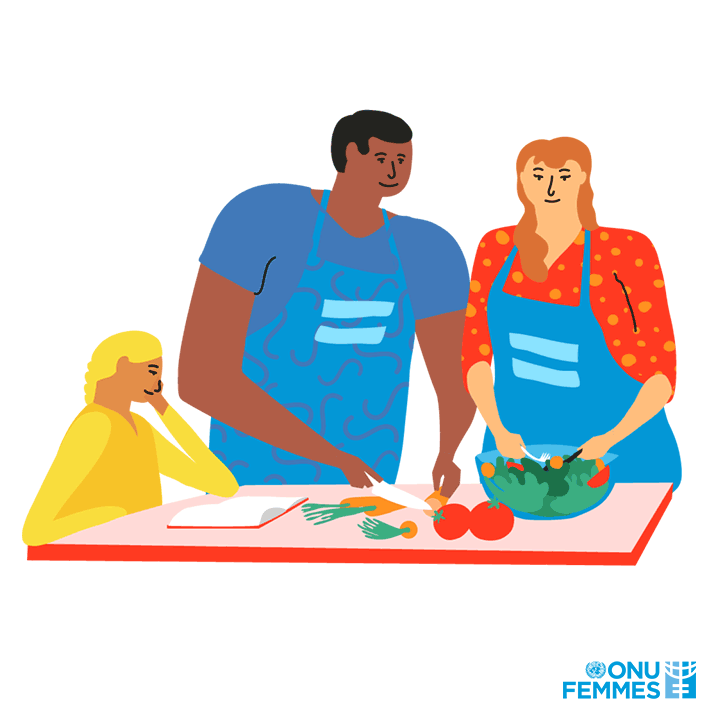Commission de la condition de la femme (CSW) : bilan Beijing+25 et adoption de la déclaration politique
La 64e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CSW) devait se tenir du 9 au 20 mars 2020 mais son organisation a été perturbée par l’épidémie actuelle du Covid-19. Une réunion officielle a tout de même pu avoir lieu le 9 mars dernier. Elle a permis l’adoption d’une déclaration politique par tous les États membres de l’ONU. Il était en effet important, malgré les circonstances actuelles, de faire le bilan et de prendre des engagements au cours de cette année qui consacre les 25 ans de la Déclaration et du Plan d’action de Pékin. La déclaration politique s’inscrit également dans le cadre de l’Agenda 2030 des Objectifs du Développement Durable (ODD).
L’adoption de la déclaration politique montre la volonté des États membres de l’ONU d'accélérer l’implémentation intégrale du Plan d’action de Pékin. Les mesures prises concernent les douzes axes thématiques du Plan d’action. Il s’agit notamment d’assurer une éducation de qualité à toutes et en particulier un meilleur accès aux domaines réservés aux hommes ; la participation égale et entière des femmes à tous les domaines (économique, politique, diplomatique, etc.), l’intégration du genre dans les politiques liées au changement climatique ou aux reconstructions post-conflit, ou encore l’élimination des violences faites aux femmes et aux filles, notamment leurs nouvelles formes via le numérique. Les États s’engagent également à de nouvelles mesures concrètes comme l’élimination de toutes les lois discriminatoires, comme celles concernant l’accès au droit de propriété et des obstacles structurels, que constituent notamment les stéréotypes de genre. Mais aussi, le déblocage de fonds proportionnés aux engagements pris, ou encore une systématisation du travail de statistiques genrées.
Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directrice Exécutive d’ONU Femmes, a ainsi déclaré : « Le bilan sur les droits des femmes montre que, malgré certaines avancées, aucun pays n’a atteint l’égalité des sexes. » (1).
Certaines avancées concernant l’égalité de genre ont eu lieu au cours de ces dernières années et sont mises en avant dans la déclaration ainsi que dans le rapport du Secrétaire général des Nations-Unies. Dans le domaine de l’éducation tout d’abord, puisque ces dernières années ont vu une augmentation du taux de scolarisation des filles. On peut ainsi observer une quasi parité dans l’accès à l’éducation dans la majorité des pays. Dans le domaine de la santé, on note des progrès importants, notamment une baisse de 38% de la mortalité maternelle entre 2000 et 2017 (2). La pauvreté extrême a également baissé grâce à l’introduction ou au renforcement de programmes de protection sociale mais elle continue d’affecter disproportionnellement les femmes et les filles.
Les États membres de l’ONU ont aussi prouvé leur capacité à légiférer la question des violences faites aux femmes. Ce sont aujourd’hui trois pays sur quatre qui possèdent des législations sur les violences domestiques (3).
Un développement encourageant en matière d’inclusivité concerne la prise en compte grandissante de la perspective intersectionnelle dans la dénonciation des violences et discriminations subies. Ces avancées sont dues à la détermination de la société civile, notamment des organisations féministes, des agences onusiennes comme ONU Femmes, ainsi que de la volonté de certains États.
Ces avancées sont certes réjouissantes mais elles restent cependant trop irrégulières et lentes, comme le souligne la déclaration politique. Les améliorations observées ne doivent pas cacher les nombreux efforts qui restent à faire. Très peu des engagements pris lors de la conférence mondiale sur les droits des femmes de Pékin, il y a 25 ans, ont été remplis.
Le manque de participation des femmes et de parité est criant dans de nombreux domaines. Elles sont encore trop peu nombreuses dans les postes à responsabilité et dans les prises de décision, que ce soit dans le domaine politique, économique, ou dans les processus de paix. À l’échelle mondiale, en 2018, ce sont seulement 27% des positions managériales dans les gouvernements, grandes entreprises et autres institutions qui sont tenues par des femmes (4). Les hommes contrôlent toujours les trois quarts des sièges parlementaires dans le monde (cf. image) (5).
Les politiques, parfois ambitieuses, ne peuvent réaliser leurs objectifs du fait d’un manque persistant de financement. Les femmes sont encore payées entre 16 % et 22 % de moins en moyenne que les hommes dans le monde (6). Les budgets alloués aux questions d’égalité sont bien trop insuffisants.
Aujourd’hui, les inégalités de genre sont encore une réalité trop répandue. Elles sont largement dues à la persistance de normes sociales et de stéréotypes néfastes. Le travail de sensibilisation et de changement des mentalités reste un des défis encore trop peu appréhendés. Les femmes réalisent encore trois fois plus de soins non rémunérés et de travaux ménagers que les hommes (7). En Afrique du Nord et en Asie occidentale, cet écart peut être de six fois supérieurs (8).
Les violences de genre sont encore très présentes et menacent de nombreuses femmes et filles. 30 % des femmes dans le monde subissent des violences physiques ou sexuelles par un partenaire au cours de leur vie (9). En 2017, 137 femmes par jour ont été tuées par une personne de leur famille dans le monde (10).
De nouveaux défis viennent s’ajouter aux problématiques discutées il y a 25 ans à Pékin, par exemple, le changement climatique qui touche inégalement les femmes et les hommes. Dans 61 pays en développement pour lesquels des données sont disponibles, les femmes sont responsables de la collecte de l’eau dans 80 % des foyers n’y ayant pas accès (11), les femmes et les filles sont ainsi fortement touchées par la désertification. Le développement de nouvelles technologies doit lui aussi se faire de manière égalitaire, et non renforcer les inégalités. À ces défis globaux viennent s’ajouter des tendances conservatrices dangereuses pour les droits des femmes et des filles dans de nombreux pays. La vigilance est de mise face aux contrecoups qui succèdent parfois aux avancées égalitaires.
Les engagements pris dans la déclaration politique concernent les États membres de l’ONU. Mais ces derniers ne sont pas les seuls acteurs de l’égalité bien qu’ils restent les principaux responsables de l’atteinte des objectifs qu’ils ont pris. La dynamique est également assurée par la participation de la société civile et du secteur privé.
À cette déclaration politique suivrons les recommandations formulées par les coalitions d’actions lors du Forum Génération Égalité, à Paris, du 7 au 10 juillet 2020 (12).
Pour conclure, comme exprimé par Phumzile Mlambo-Ngcuka : « Le monde n’est pas inclusif et égalitaire, et nous devons agir maintenant pour faire en sorte qu’il ne soit plus discriminatoire à l’égard des femmes. Seule la moitié représente une part égale et seule l’égalité est suffisante » (13).
Lorelei Colin
(1) Communiqué de Presse ONU Femmes
(2) Rapport du Secrétaire Général, page 40
(3) Rapport du Secrétaire Général, page 64
(4) Rapport du Secrétaire Général, page 5
(5) Rapport du Secrétaire Général, page 4
(6) Rapport du Secrétaire Général, page 23
(7) Rapport du Secrétaire Général, page 25
(8) Rapport du Secrétaire Général, page 25
(9) Rapport du Secrétaire Général, page 59
(10) Rapport du Secrétaire Général, page 61
(11) Rapport du Secrétaire Général, page 108
(12) Au vu de la situation mondiale liée au coronavirus, le calendrier du Forum Génération Égalité est en cours de révision
(13) Communiqué de Presse ONU Femmes